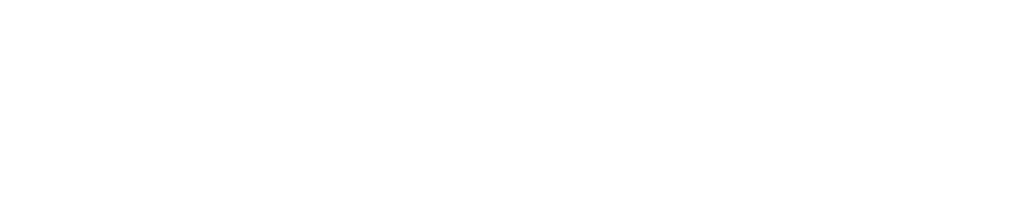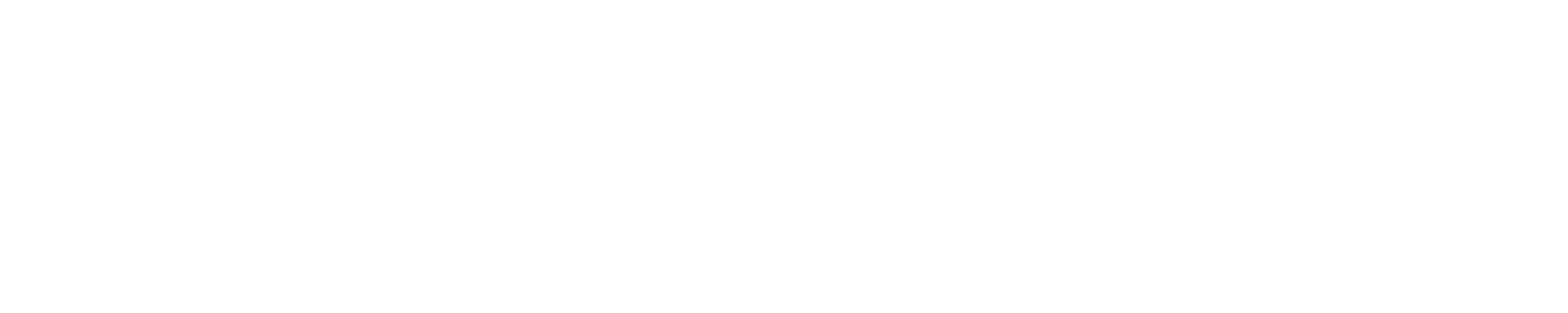La Fécondation In Vitro, communément appelée FIV, est une technique de procréation médicalement assistée (PMA) qui permet à des couples infertiles ou à certaines personnes seules ou en couple homosexuel d’avoir un enfant. Depuis la naissance du premier « bébé-éprouvette » en 1978, cette méthode a connu de nombreuses avancées, devenant un pilier de la médecine reproductive moderne.
Qu’est-ce que la FIV ?
La FIV est une technique qui consiste à féconder un ovule par un spermatozoïde en laboratoire, en dehors du corps de la femme. Une fois l’embryon formé, il est ensuite transféré dans l’utérus pour poursuivre son développement, comme dans une grossesse naturelle.
Cette méthode s’adresse principalement aux couples présentant une infertilité persistante malgré d’autres traitements. Elle est également utilisée dans des cas d’infertilité inexpliquée, de troubles ovulatoires, d’endométriose, ou encore lorsque les trompes de Fallope sont bouchées ou absentes.
Les principales indications de la FIV
La FIV peut être indiquée dans plusieurs cas :
- Infertilité tubaire : en cas d’obstruction ou d’altération des trompes.
- Endométriose : une maladie qui peut nuire à la fécondation naturelle.
- Infertilité masculine : quand le sperme est de faible qualité ou en quantité insuffisante.
- Infertilité inexpliquée : lorsqu’aucune cause précise ne peut être identifiée.
- Échecs d’insémination intra-utérine.
- Préservation de la fertilité : pour des patientes avant un traitement contre le cancer, par exemple.
Depuis l’évolution des lois en France et dans d’autres pays, la FIV est également accessible aux femmes célibataires et aux couples de femmes souhaitant fonder une famille.
Les étapes de la FIV
Le processus de FIV comprend plusieurs étapes, nécessitant un suivi médical rigoureux :
1. Stimulation ovarienne
La femme suit un traitement hormonal pour stimuler ses ovaires et obtenir plusieurs ovocytes (ovules). Cela permet d’augmenter les chances de réussite en ayant plusieurs embryons potentiels.
2. Ponction des ovocytes
Lorsque les follicules sont matures, une ponction ovarienne est réalisée sous anesthésie légère. Les ovocytes sont recueillis à l’aide d’une aiguille fine guidée par échographie.
3. Recueil et préparation du sperme
Le sperme du conjoint ou d’un donneur est recueilli et préparé en laboratoire pour isoler les spermatozoïdes les plus mobiles.
4. Fécondation en laboratoire
Les ovocytes et les spermatozoïdes sont mis en contact. On peut utiliser deux méthodes :
- FIV classique : les gamètes sont simplement mis ensemble pour une fécondation naturelle.
- ICSI (Injection Intracytoplasmique de Spermatozoïde) : un spermatozoïde est directement injecté dans l’ovocyte, utile en cas de problèmes de mobilité ou de nombre des spermatozoïdes.
5. Culture embryonnaire
Les embryons obtenus sont cultivés pendant plusieurs jours en laboratoire. Ils sont observés pour suivre leur développement.
6. Transfert embryonnaire
Un ou deux embryons sont transférés dans l’utérus de la femme. Le reste peut être congelé pour une utilisation ultérieure.
7. Test de grossesse
Environ deux semaines après le transfert, un test sanguin permet de savoir si la FIV a abouti à une grossesse.
Taux de réussite de la FIV
Le taux de réussite varie en fonction de nombreux facteurs : âge de la femme, cause de l’infertilité, qualité des embryons, etc. En moyenne, le taux de grossesse par tentative est d’environ 25 à 30 %, mais ce chiffre diminue avec l’âge, surtout après 38 ans.
Grâce aux progrès techniques (culture prolongée, vitrification, diagnostic génétique préimplantatoire), les chances de réussite ont cependant nettement augmenté ces dernières années.
Les avantages de la FIV
- Offrir une chance à de nombreux couples infertiles.
- Permettre un diagnostic génétique avant implantation pour éviter certaines maladies héréditaires.
- Autoriser la congélation des embryons, ce qui limite le nombre de stimulations ovariennes.
- Encadrer la reproduction dans un cadre médical et éthique.
Les risques et les effets secondaires
La FIV n’est pas sans inconvénients :
- Effets secondaires hormonaux : bouffées de chaleur, troubles de l’humeur, douleurs abdominales.
- Syndrome d’hyperstimulation ovarienne : parfois grave, bien que de plus en plus rare grâce aux protocoles modernes.
- Grossesses multiples : en cas de transfert de plusieurs embryons, bien que cela soit de moins en moins pratiqué.
- Stress émotionnel et psychologique, dû aux attentes, aux échecs, ou aux contraintes du traitement.
Il est donc essentiel que les patientes soient accompagnées psychologiquement tout au long du parcours.
Aspects éthiques et législatifs
La FIV soulève aussi des questions éthiques : statut de l’embryon, anonymat du don, congélation, droit à l’enfant pour tous, etc.
En France, la loi encadre strictement la FIV. La dernière révision de la loi de bioéthique en 2021 a élargi l’accès à la PMA à toutes les femmes, qu’elles soient en couple ou célibataires. Le don de gamètes y reste anonyme et gratuit.
D’autres pays ont des législations plus souples ou plus strictes, poussant certains couples à recourir au tourisme médical pour accéder à des traitements interdits ou non remboursés dans leur pays.